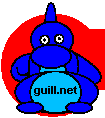

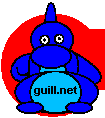 |
guill.net
-
La page des réseaux
|
 |
|
|
|
Le code de la propriété
intellectuelle (CPI) reconnaît aux auteurs d’œuvres de l’esprit originales,
quelle qu’en soit la forme, des droits patrimoniaux et
moraux sur l’œuvre.
Nous nous limiterons ici
à une courte étude des droits patrimoniaux à l’intention
des internautes qui surfent sur le web ou qui entendent créer leur
site
dans lequel ils souhaitent
intégrer des œuvres de l’esprit dont ils ne sont pas les auteurs.
1
– Quelles sont les œuvres protégées par le droit d’auteur
?
La notion d’œuvres de l’esprit
recouvre un large éventail de créations de formes.
L’article L112-1 du CPI
précise que la protection par le droit d’auteur est conférées
aux œuvres « quelles qu’en soient le genre, la forme d’expression,
le
mérite ou la destination.
»
Ainsi, une œuvre utilitaire,
si elle est originale, sera protégée au même titre
qu’une œuvre d’art. De même, quelle que soit la valeur esthétique
de l’œuvre
elle sera protégée
par le CPI.
L’article L 112-2 du CPI
donne une liste non exhaustive des œuvres protégées par le
droit d’auteur. On y trouve notamment les textes, les discours, les
œuvres musicales, les œuvres
cinématographiques, les images, les logiciels, les bases de données
(soumises à un double régime de protection…lien
article bdd) …
Ces œuvres seront protégées
par le droit d’auteur dès lors qu’elles sont originales. La notion
d’originalité a fait l’objet de nombreuses discussions de la
doctrine.
Elle s’entend généralement
comme un apport intellectuel propre à son auteur. Ainsi,
à partir du moment
où la forme de l’œuvre n’est pas entièrement dictée
par le but à atteindre et que l’auteur fait des choix dans la création
de l’œuvre,
celle ci sera protégée
par le droit d’auteur.
Echappent donc à la
protection par le droit d’auteur, les idées, les faits, les créations
de forme non originales. Les idées sont par principe de libre
parcours.
La distinction forme/idée
est parfois difficile à mettre en œuvre.
On peut prendre l’exemple
d’un fait divers relaté par un article de presse. Les événements
relatés par l’article pourront être racontés différemment.
Seule
la reprise de la forme de
l’article (reprise de l’expression ou de la composition) sera jugée
contrefaisante.
Ainsi pour résumer, sont protégées par le droit d’auteur toutes les créations de forme comportant un apport intellectuel propre à leur auteur.
2
- Quels sont les droits reconnus à l’auteur sur son œuvre ?
Parmi les droits patrimoniaux exclusifs reconnus à l’auteur, on trouve principalement, le droit de reproduction et le droit de représentation.
La représentation
est la communication de l’œuvre au public par tout procédé,
y compris la télédiffusion (article L –122 –2 du CPI).
La reproduction consiste
dans la fixation matérielle, de l'œuvre par tous procédés
qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte
(Article L 122-3 du CPI).
Cette division originelle
s’est adaptée au fur et à mesure à toutes les évolutions
techniques telles que l’apparition des mécanismes d’enregistrement,
l’apparition de la radio,
de la télévision …
En effet, il faut rappeler
que contrairement au droit américain, le droit français est
un droit synthétique, ce qui signifie que les hypothèses
envisagées par
la loi sont assez larges
pour s’adapter aux réalités nouvelles (le droit américain
au contraire, doit viser une situation très précisément
pour que la règle de
droit s’y applique).
3
- Ces droits sont ils applicables sur Internet ?
Oui, les droits de reproduction et de représentation trouvent à s’appliquer sur Internet.
A – L’édition de contenus
Tout acte de diffusion d’une œuvre sur Internet implique nécessairement la mise en œuvre de ces deux droits.
En effet, la jurisprudence
a estimé que toute numérisation de l’œuvre constitue une
reproduction. De plus, il y a reproduction sur le serveur (ordinateur
sur lequel sont stockées
les pages consultées) et éventuellement sur l’écran
et/ou le disque dur de l’internaute. La mise en ligne de cette reproduction
trahit incontestablement
la volonté de l’auteur de communiquer l’œuvre au public. Il y a
donc bien fixation matérielle en vue de communiquer l’œuvre au
public de manière
indirecte.
Il y a aussi représentation
dans la mesure où l’œuvre est communiquée au public par télédiffusion,
comme le vise expressément le code de la propriété
intellectuelle.
Les premières affaires concernant la mise en ligne des œuvres ont confirmé que ces notions trouvent à s’appliquer sur le web.
La diffusion sur le Réseau
d’une œuvre protégée par le droit d’auteur constitue à
la fois une reproduction et une représentation. Il faudra donc être
vigilant
à ne pas intégrer
dans sa page des éléments avant d’avoir obtenu l’autorisation
de leur auteur.
B - La consultation de contenus
Qu’en est-il de l’internaute qui visualise et, le cas échéant télécharge ou imprime une œuvre protégée par le droit d’auteur ?
Si l’auteur n’a pas consenti
à ce que son œuvre soit reproduite sur le serveur ou à ce
qu’elle soit représentée sur Internet, l’internaute qui télécharge
ou
imprime une œuvre sera coupable
de recel de contrefaçon. La fixation de l’œuvre téléchargée
réalisée par l’internaute pour son usage personnel n’étant
pas destinée à
être communiquée au public, il n’y a pas violation du droit
de reproduction de l’auteur par l’internaute.
Cependant, l’utilisateur
détient alors une chose provenant d’un délit (le délit
de contrefaçon réalisé par la personne qui a mis en
ligne les œuvres sans
l’accord de l’auteur) et
se rend donc coupable de recel. Il appartiendra à l’auteur de prouver
la détention (élément matériel de l’infraction)
et que
l’utilisateur était
conscient du fait que l’auteur n’avait pas autorisé le téléchargement
de l’œuvre (élément intentionnel de l’infraction). Ce délit
est différent
du délit de contrefaçon
pour lequel la mauvaise foi du contrefacteur (élément intentionnel)
est présumée.
Le recel est puni de 5 ans
d’emprisonnement et de 2 500 000 francs d’amende.
Il faut rappeler que les
avertissements proposés par nombre de sites illicites affirmant
que la loi autorise à garder le fichier sur disque dur pendant un
temps déterminé
n’ont aucune valeur juridique. Le simple fait de télécharger
une contrefaçon est une infraction, indépendamment du temps
que l’on
conserve l’œuvre.
La visualisation de l’œuvre
semble épargnée par cette sanction. En effet, si l’on considère
là aussi que l’internaute « détient » la chose
objet du délit, ce
qui reste encore à
démontrer, la preuve de l’élément intentionnel sera
fort difficile à rapporter en raison de la nature d’internet qui
conduit de liens en liens
vers des sites qui peuvent
s’avérer contrefaisants.
4
- Les traditionnelles exceptions au droit d’auteur s’appliquent-elles
à l’Internet ?
Le CPI Le droit d’auteur
supporte certaines exceptions, et principalement, l’exception de copie
privée, l’exception de représentation dans le cercle de
famille, et l’exception
de courte citation, ainsi que les exceptions de revue de presse et de parodie.
Ces exceptions sont prévues par l’article L 122-5 Du
CPI.
A - L’exception de copie privée
L’auteur ne peut interdire
les copies ou reproductions strictement réservées à
l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation
collective. Pour
les logiciels, l’auteur
ne peut interdire la copie de sauvegarde (à moins de fournir le
logiciel avec une copie de sauvegarde, auquel cas l’utilisateur est
empli de ses droits selon
la jurisprudence) (article L122-5 du CPI).
Cette exception de copie
privée à été invoquée au cours de tous
les procès relatifs à la violation d’un droit d’auteur sur
Internet. Les contrefacteurs
affirmaient que les œuvres
mises en ligne avaient été reproduites sur des pages privées
pour leur usage personnel.
Tout d’abord, nous l’avons
dit, la mise en ligne d’une œuvre trahit presque nécessairement
l’idée de communication de l’œuvre au public. Presque
nécessairement, car
il faut réserver le cas des pages protégées par un
mot de passe.
En effet, imaginons, qu’un
internaute veuille se constituer une discothèque, à partir
de ses propres disques, accessible de n’importe quel ordinateur
partout dans le monde. Il
copiera donc ses fichiers sur un serveur, et protégera l’accès
à ce serveur par un mot de passe pour être le seul à
y avoir
accès. On se trouverait
bien là dans une hypothèse de copie privée. Il y aura
cependant contrefaçon si l’internaute décide de diffuser
son mot de passe.
Dans cette hypothèse
toutefois, la preuve de la contrefaçon serait fort difficile à
apporter.
Ainsi, la jurisprudence a
d’abord écarté l’exception de copie privée pour une
œuvre diffusée sur un site ouvert au motif que la mise en ligne
sans
restriction d’accès
favorisait l’utilisation collective de l’œuvre.(TGI de PARIS, Ordonnance
de référé, 5 mai 1997).
Cependant, dans une ordonnance
de référé du 10 juin 1997, le TGI de Paris a affirmé
que la reproduction d’une œuvre sur une page protégée accessible
au public en raison d’une
défaillance technique du système de protection ne permettait
pas de caractériser la contrefaçon. Toutefois, il faudra
attendre
les décisions ultérieures
pour mesurer la portée de cette décision fort critiquée
par la doctrine.
Pour finir sur ce point,
il faut préciser que la copie privée doit être réservée
à l’usage du copiste. Cela signifie que seule la personne qui effectue
la copie
privée a le droit
d’utiliser l’œuvre.
On peut donner l’exemple
de la copie d’un CD pour avoir une copie chez soi et une autre dans sa
voiture. La copie de l’œuvre ne pourra pas être utilisée
par une autre personne.
B - La représentation dans le cercle de famille
L’article L 122-5 du CPI
dispose que l’auteur ne peut interdire « les représentations
privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle
de
famille. »
La jurisprudence a interprété
de manière très restrictive cette notion de cercle de famille.
Elle a par exemple refusé l’extension de cette notion à une
représentation d’un
film dans une maison de retraite. De même, la jurisprudence a-t-elle
considéré qu’un groupe de travail ne constituait pas un cercle
de
famille au sens de l’article
L122-5.
Cependant, dans son ordonnance
de référé du 10 juin 1997, le TGI de Paris semble
considéré qu’un groupe de travail constitue un cercle de
famille.
Cette position a été
fortement critiquée par la doctrine.
Il est évident qu’une
page accessible au public et dûment référencée
dans les moteurs de recherche et autres annuaires ne pourrait donner prise
à
l’application de cette exception.
L’internaute qui met en ligne
des œuvres de l’esprit sans l’autorisation de leur auteur peut-il arguer
du fait que ses pages sont exclusivement destinées à
son cercle de famille, seules
personnes à qui il a divulgué le mot de passe nécessaire
à l’accès au site ?
Non, car la reproduction
de l’œuvre pour la mettre en ligne ne sera pas ici une copie privée
réservée à l’usage du copiste, puisqu’elle est destinée
au
cercle de famille. Ainsi,
l’œuvre mise en ligne devient-elle contrefaisante et l’exception de représentation
dans le cercle de famille ne trouve pas à
s’appliquer.
Si toutefois le copiste avait obtenu l’autorisation de l’auteur de reproduire l’œuvre pour l’usage de son cercle de famille, il n’y aurait pas contrefaçon.
Il faut toutefois préciser
que l’analyse ci-dessus se fait au regard des principes du droit d’auteur.
Il semblerait cependant qu’une telle utilisation d’une
œuvre ne serait, dans les
faits, pas jugée digne de poursuites, dans le cas où elle
se limite au cercle de famille. Cependant, ce sera à l’internaute
de
prouver que l’utilisation
de l’œuvre s’est limitée au cercle de famille, car en matière
de contrefaçon, la mauvaise foi est toujours présumée.
C - L’exception de courte citation
L’article L-122-5 dispose
que sous réserve que soient clairement indiqués le nom de
l’auteur et la source de l’œuvre, l’auteur ne peut interdire les courtes
citations de son œuvre à
des fins critiques, polémiques, pédagogiques, scientifiques
ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées.
Cette exception est interprétée
fort restrictivement par la jurisprudence qui jusqu’ici n’a admis son application
que pour les œuvres littéraires (et l’a
refusée aux œuvres
musicales, audiovisuelles et aux œuvres des arts plastiques). Cette extrême
limitation est fort critiquée par la doctrine. En effet,
sous réserve de ne
pas porter atteinte au droit au respect de l’auteur sur l’intégrité
de son œuvre, l’exception de courte citation semble devoir s’appliquer
à toutes les formes
d’œuvres.
Pour mesurer la courte citation,
les tribunaux comparent la longueur de l’œuvre citée à la
longueur de l’œuvre citante. Il faut que la citation soit brève
par
rapport à l’œuvre
citée et qu’elle ne soit qu’un accessoire de l’œuvre dans laquelle
elle s’insère.
Il faut donc tout d’abord
une œuvre citante. Une page web où ne figurerait que la citation
de l’œuvre ne pourrait constituer une courte citation. Ainsi, dans
l’ordonnance de référé
du TGI de Paris en date du 5 mai 1997, le tribunal estime que le fait qu’un
recueil de poèmes ait été numérisé dans
son
ensemble, fait obstacle
à l’application de l’exception de courte citation, et ce,
même si l’utilisateur ne pouvait accéder aux poèmes
qu’individuellement.
D – L’exception de revue de presse
L’article L-122-5 du CPI
dispose que sous réserve que soient clairement indiqués le
nom de l’auteur et la source de l’œuvre, l’auteur ne peut interdire les
revues de presse.
La Cour de Cassation a défini
la revue de presse en affirmant qu’elle « suppose nécessairement
la présentation conjointe et par voie de comparative de
divers commentaires émanant
de journalistes différents et concernant un même thème
ou un même événement. » (Cass. Crim. 30
janvier 1978).
Cette définition ne semble pas poser de problèmes particulier concernant Internet.
En respectant les conditions ainsi posées, on peut librement réaliser des revues de presse sur Internet.
E – L’exception de parodie
L’article L122-5-4 pose le principe de l’exception aux droits d’auteur pour la parodie le pastiche et la caricature « compte tenu des lois du genre ».
Deux conditions sont utilisées. Il faut que la parodie ait pour but d’amuser le public, et qu’il n’y ait pas de confusion avec l'œuvre d'origine.
Bien qu’Internet facilite ce genre qui foisonne sur le web , aucune décision n’a permis pour l’instant de déterminer les limites applicables à cet exercice.
5
– Quelles œuvres puis-je mettre sur mon site sans l’autorisation de leur
auteur ?
Uniquement les faits, les
idées, les méthodes ainsi que les créations de forme
non originales ou encore les créations tombées dans le domaine
public
(70 ans après la
mort de l’auteur ou du dernier des coauteurs pour les œuvres de collaboration)
sous réserve du droit reconnu aux producteurs de bases
de données.
En effet, si les faits ou
les créations non protégées par le droit d’auteur
sont extraits d’une base de données, il conviendra de prêter
attention au droit sui
generis des producteurs
de bases de données.
Si la constitution de la
base en question a nécessité un investissement substantiel
qu’il soit humain, technique ou financier, le producteur pourra
s’opposer à l’extraction
de parties substantielles de la base, ou à l’extraction systématique
et répétée d’éléments de la base.
Ainsi, par exemple, un site
économique pourrait-il éventuellement s’opposer à
l’extraction et à la rediffusion des chiffres collectés et
réunis dans une
base de données,
si la reprise est systématique ou si elle concerne des éléments
substantiels de la base de données.
Je pourrais également
utiliser l’exception de courte citation à des fins critique, polémique,
pédagogique, scientifique ou d’information, en mentionnant le
nom de l’auteur et la source,
mais nous l’avons vu, il faudra agir de manière fort mesurée
pour ne pas encourir la sanction des tribunaux.
Je pourrais réaliser
des revues de presse, sous réserve d’indiquer clairement le nom
de l’auteur et la source de l’article pour comparer l’avis de
journalistes sur un même
thème.
Enfin, je pourrais faire des parodies d’œuvres existantes à caractère humoristique qui ne créent pas de confusion avec l’œuvre originale.