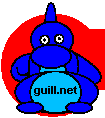

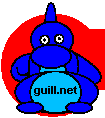 |
guill.net
-
La page des réseaux
|
 |
|
|
|
1.Architecture
Les services de transmission de données se sont développés, depuis le début des années 70, sur le principe des réseaux spécialisés : à un usage correspondait un réseau spécifique. L’utilisateur qui avait besoin de communiquer avec chacun de ces réseaux était donc obligé d’avoir autant de raccordements que de réseaux ou d’applications à atteindre.
Cette multitude de raccordements
différents et indépendants n’était optimale ni du
point de vue de l’utilisateur ni point de vue de l’exploitant Télécom
; de cette constattation est né le concept d’intégration
de services.
Ce réseau s’appuie
sur le concept RNIS (Réseau Numérique à Intégration
de Services) ou ISDN (Integrated Services Digital Network). Le RNIS propose
l’intégration des supports et des services et, pour cela, il s’appuie
sur la numérisation et se développe au sein d’une structure
puissante de normes internationales.
Le RNIS est une évolution du réseau téléphonique actuel. Il propose la continuité numérique de bout en bout. Ce n’est pas un réseau supplémentaire entrant en concurrence avec les réseaux existants comme le téléphonique traditionnel, les réseaux X.25 ou les liaisons spécialisées. C’est plutôt un accès universel à ces réseaux ou plus exactement à ces services supports.
En jouant sur son sigle , le RNIS apparaît comme un moyen de communication rapide, normalisé, intelligent et souple :
? rapide, car l’accès
de base à 144 Kbit/s comporte 2 voies à 64 Kbit/s et une
voie à 16 Kbit/s (2B+D). Les canaux B permettent, par exemple,
de téléphoner tout en envoyant une télécopie
rapide. Le canal D, pour sa part, convoie les signaux servant à
l’établissement de la communication et toutes les informations de
service ; il peut aussi transporter des informations à bas débit.
Il existe des accès primaires qui comportent 30 canaux B et un canal
D.
? Normalisé, car
tous les éléments d’accès au RNIS sont spécifiés
par des normes internationales : même canal de base, même canal
D, même cablâge et même prise (RJ 45) servent pour tous.
? Intelligent, car les centraux
sont capables de gérer une signalisation bien plus riche que celle
du téléphone classique. Cette possibilité offre un
grand nombre de services complémentaires comme, par exemple, l’identification
de l’appelant ou la possibilité de transfert d’appel. Par ailleurs,
il existe un contact permanent entre l’abonné et le réseau
; par exemple, si un abonné occupe ses 2 canaux B avec une communication
téléphonique et un transfert de données, le réseau
pourra, grâce au canal D, avertir l’utilisateur qu’un autre correspondant
cherche à le joindre.
? Souple et simple, car
le RNIS a la vocation d’héberger la grande majorité des services
de communication et fait un pas vers
la transparence des réseaux
avec son accès universel aux services de télécommunication.
2.Spécifications
Le LAPD (Link Access Protocol – channel D) is un protocole de niveau 2 qui travaille avec l’Asynchronous Balanced Mode (ABM). Ce mode est complètement équilibré (ni maitre, ni esclave). Chaque station peut intialiser, superviser et envoyer des trame à tout moment.
Le format de la rame est décrit ci-dessous:
![]()
Champs :
Flag : Sa valeur est toujours (0x7E). De sorte à ce que le flag ne soit pas dupliqué dans la trame on utilise la technique du Bit Stuffing.
Adresse : Les 2 premiers octets de la trame après le champ flag sont les champs d’adresse. Le format de Adresse est le suivant :
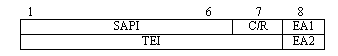
EA1 : premier bit d’extension d’adresse qui est toujours 0
C/R : bit Commande/Réponse. Les trames qui proviennent d’un utilisateur avec ce bit à 0 sont des trames de commande
SAPI : Service Access
Point Identifier.
Les valeurs sont :
0 procédure appel-contrôle
1 mode communication de
paquets utilisant la procédure d’appel-contrôle I.451
2 communication de paquets
X.25 niveau 3
3 manager de procédures
niveau 2
Contrôle : identifie le type de trame avec un contrôle sur la trame
FCS : Frame
Check Sequence.
STRUCTURE DE LA TRAME RNIS
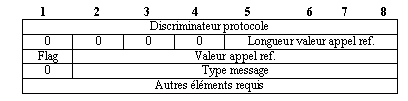
Champs :
Discriminateur protocole : protocole utilisé
Longueur valeur appel référence : détermine la longueur du champ suivant. La référence d’appel peut être d’une longueur de 1 ou 2 octets qui dépend de la taille de la valeur codée.
Flag : mis à 0 pour les messages émis par le parti qui à alloué la valeur de l’appel de référence ; autrement mis à 1.
Valeur appel ref : une valeur arbitraire est allouée pour la durée de la session, qui identifie l’appel entre la machine maintenant l’appel et le switch RNIS
Type message : définit
le premier sujet de la trame. Le type de message peut être de 1 ou
2 octets. Quand il y a plus d’un octet, le premier octet ne contient que
des 0.